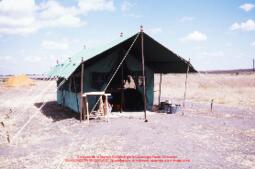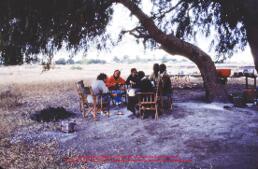Cette documentation a été rassemblée par François Villeneuve.
Photocopies d'articles, d'ouvrages, notes de travail, rapports, tirés à part, documents graphiques, photographies.
APO2321. De 1 à 7.
APO2322. De 8 à 14.
APO2323. De 15 à 18.
APO2324. De 19 à 26.
APO2325. De 27 à 38.
APO2326. De 39 à 52.
Présence d'un rapport sur une prospection islamique, 1991 (n°52).
Liste des thématiques jointe au dossier.
Texte de communication.
Intitulé de la communication de Claude Lepelley : « Chrétiens et païens au temps de la persécution de Dioclétien : le cas d’Abthugni ».
Texte de communication.
Jacques Tixier ne s’est pas rendu au colloque mais a transmis un texte intitulé « Typologie fonctionnelle et typologie morphologique ». La préparation de ce texte n’est pas conservée dans le dossier.
Circulaire, lettres, note.
Textes préliminaires de publication, texte de la communication "Pollens et terrasses marines au Liban", lettre.
Présence de documents s.d.
Intitulé de la communication de Claude Lepelley : « Nouveaux documents sur la vie municipale dans l’Afrique romaine tardive. Éléments d’un supplément épigraphique aux Cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire »
Documentation, photographies (tirages), notes de travail, lettres, tiré à part.
Photographies.
Diapositives de 1985-1988, 1992-1995, 1998 et 2001.
Présence de légendes détaillées sur les diapositives.
Ce dossier rassemble des vues de la vie quotidienne sur le chantier, des portraits des équipes, des fouilleurs et des visiteurs, des paysages, de la faune et et de la flore et des scènes de la vie locale.
Présence d'une diapositive sans date classée en fin d'article.
Ce dossier regroupe les photographies de l'équipe de fouilles, des visites du site, des paysages et des vues de chantier ou de matériel utilisées pour des publications, des rapports ou des posters. Les photographies ne sont pas légendées.
Intitulé de la communication de F. Joannès : "Le travail des artisans en Babylonie récente" ou "Contrats de travail à l'époque néo-babylonienne".
Textes préparatoires des actes, notes, documentation, programme, circulaires.
Les auteurs du plan sont Charles Marteaux et L. Revon.
Les onglets portent les intitulés suivants :
Japon
Ensemble (Europe, Bretagne, Estonie, France, Russie, Asie, Indochine, Malaisie, Afrique, Océanie)
Tête (couronne, voile, turban, calotte, chapeau, capuchon, visière)
Cou
Tronc (cape, drapé, droit (fermé, ouvert, croisé) coupé (fermé, ouvert, croisé)
Ceinture (tablier, slip, slip à pans, pagne, jupe, culotte)
Bras
Jambe
Pied (sandales, socque, mocassin, soulier, sabot, botte, patin, raquette, ski)
Accessoires
L’art plastique de figurines et récipients anthropomorphes n’était pas destiné à la vie quotidienne : il avait surtout des usages beaucoup plus reliés à des ensembles de rites, funéraires, chamaniques, voire religieux. Dans la plupart de ces représentations, la frontalité se conjugue très souvent à des attitudes statiques. La symétrie est le plus souvent parfaite. Les pieds sont au même niveau, les jambes droites et raides, les bras sont fréquemment plaqués le long du torse ou détachés du tronc, maintenus à mi-hauteur. Les personnages assis sont le plus souvent placés sur un petit siège bas et dans une posture droite, les mains reposant sur les cuisses ou sur les genoux. Certains tiennent les objets d’usage habituel dans la mastication de la coca : le poporo (récipient à chaux) et l’aiguille ou l’instrument oblong servant à extraire cette chaux du récipient. Moins souvent, les personnages sont assis à même le sol, les jambes croisées « en tailleur » ou en position dite « du lotus », comme c’est le cas du récipient « canastero », associé à une figurine anthropomorphe qui semble ainsi porter dans son dos une hotte.
L’orfèvrerie
L’orfèvrerie de Tumaco La Tolita est sans doute la plus ancienne des Andes du nord. Elle se compose quasi-exclusivement de pièces réalisées en or, mais parfois, celui-ci contient en faible proportion du platine que les orfèvres parvenaient ainsi à travailler en l’incluant à l’or en fusion. Une grande part des objets correspond à des éléments de parure et à des ornements corporels et faciaux. Ces vestiges proviennent des sépultures où ils étaient déposés en offrandes funéraires, certains furent auparavant utilisés par les défunts, comme ornements et insignes de pouvoir. On connaît toutefois quelques objets utilitaires : aiguilles à chas, épingles, poinçons, agrafes, hameçons…Les techniques employées pour la fabrication font surtout appel au martelage, impliquant un fréquent « recuit » des objets en cours de fabrication. Les orfèvres maîtrisaient aussi parfaitement les techniques d’assemblage par emboîtage et aussi par soudure. Sur les éléments élaborés à partir de plaques de métal, le décor était souvent fait par repoussé, pratiqué depuis l’arrière de l’objet mais aussi parfois depuis la face avant. Les orfèvres fabriquaient aussi des objets composites, mêlant des parties réalisées avec des ors de diverses couleurs, contenant plus ou moins d’inclusions de cuivre, d’argent ou de platine.